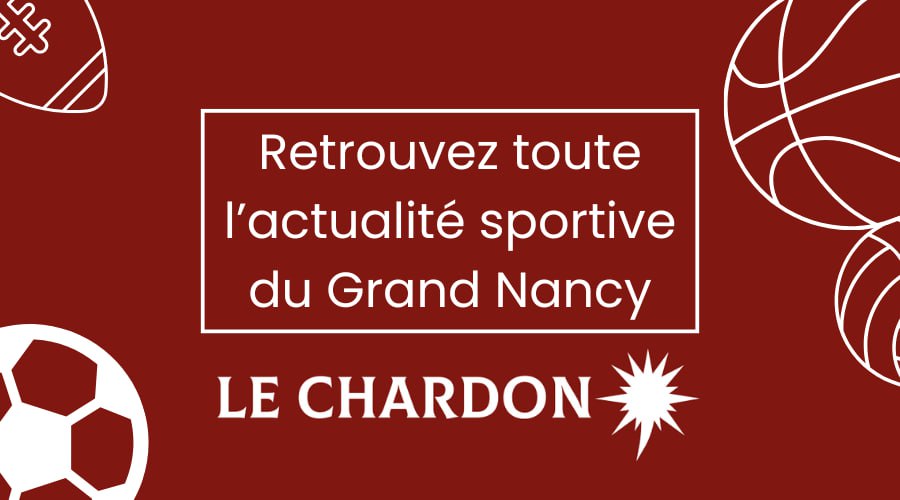Piétonnisation : à Nancy, l'appel du pied

Ces dernières années, Nancy se transforme. Au premier plan : la piétonisation. Entre la rue Saint-Nicolas et la porte de la Craffe, c’est un grand chemin piéton de 1,3 kilomètres qui a été tracé. Après les expérimentations réussies des chemins piétons estivaux, la piétonisation est effective depuis le 16 septembre 2022. Pour la première fois depuis la restauration et la piétonisation de la Place Stanislas en 2005, une nouvelle grande étape était franchie.
Alors que la première phase des travaux d’aménagement de la nouvelle aire piétonne est achevée, une deuxième phase de travaux débute en Vieille Ville : aménagements et végétalisations sont au programme pour une partie de la Grande Rue, la place de l’Arsenal, la rue Gustave Simon, ainsi que la végétalisation de la place Vaudémont. Dans l’ensemble, rendez-vous fin 2025 pour la finalisation des aménagements.
Bien sûr, une telle transformation ne se fait pas sans contestation. Entre postures politiciennes, instrumentalisations et inquiétudes légitimes, le débat sur la piétonisation est souvent passionné. Plus de deux ans après ces premiers pas, et alors que les travaux sont désormais finis sur l’axe Rue des Dominicains - Rue du Pont Mouja - Rue Saint Nicolas, un premier bilan peut être dressé.
La piétonisation, une bonne chose pour Nancy ?
En juin 2023, la Ville de Nancy publiait un point d’étape contenant une enquête d’opinion, portant sur les réponses de presque 1 500 riverains et usagers. Toutes tranches d’âge confondues, 49% se déclaraient insatisfaits, contre 48% satisfaits. Il convient ici de noter que cette étude a été menée en mars - avril 2023, soit en pleine période de travaux. Un clivage générationnel est à noter : alors que les 51-70 ans sont seulement 42% à se déclarer satisfaits, 67% des répondants de moins de 35 ans se déclaraient satisfaits ou très satisfaits des aménagements en cours.
Autre point important permettant d’évaluer l’efficacité de la piétonisation : la fréquentation. Ainsi, des mesures sur 7 points situés dans l’hyper centre ont montré qu’entre septembre 2021 et mars 2022 d’une part (soit avant la piétonisation) et septembre 2022 et mars 2023 d’autre part (après la piétonisation), ce sont plus de 750 000 visiteurs supplémentaires qui se sont rendus sur l’air piétonne. La Rue des Dominicains a par exemple enregistré une hausse de plus de 11% de sa fréquentation.
Pendant les festivités de la Saint-Nicolas, le chemin piéton fut d’autant plus apprécié. Rue du Pont-Mouja, sur le chemin très emprunté entre la place Charles III et la place Stanislas, la piétonisation a laissé l’opportunité de dynamiser l’espace : un nouveau petit village de la Saint-Nicolas s’y est installé. Portée par l’association de commerçants Nico et Mouja, le hameau éponyme était constitué de six chalets proposant raclette, vins chauds, bagel au foie gras, escargots, permettant de proposer une nouvelle étape gourmande pour les fêtes.
Au-delà de l’avis populaire, la question de l’attractivité du centre-ville a souvent été posée par les détracteurs de la piétonisation. Il s’agit en effet d’une question primordiale. De par son importance, cette problématique mérite bien plus que des postures simplement idéologiques. Prenons donc le temps de nous y pencher.
La piétonisation, catalyseur du commerce en centre-ville
En 2020, le CEREMA publiait une note synthétisant les liens entre mobilités et commerces, basée sur de nombreuses enquêtes de déplacements. Dans les territoires, les achats sont ainsi après l’activité professionnelle le deuxième motif de déplacements (20% des déplacements sur un jour moyen de semaine). Ces achats sont réalisés très majoritairement à proximité du domicile. Ainsi, dans les villes de 100 000 habitants ou plus, 64% des clients se rendent en centre-ville pour réaliser leurs achats à pied, 10% en transports en communs, et moins de 25% en automobile.
Ces chiffres nationaux se confirment dans les différentes études menées localement, y compris à Nancy. Commençons par citer l’exemple Lillois. Mathieu Chassignet, ingénieur spécialisé de la ville et des transports durables, a ainsi mené une vaste étude avec Sciences Po Lille en octobre 2021. Le principal enseignement tiré de cette étude est éloquent : les clients viennent avant tout à pied (42% des clients accèdent au centre-ville à pied), alors que l’automobile représente moins d’un quart des déplacements (seulement 21% des clients utilisent leur voiture pour réaliser leurs achats en centre-ville). Cette part de clients utilisant l’automobile et même largement inférieure aux clients utilisant les transports collectifs (21% les transports collectifs urbains et 7% le train). Deuxième enseignement de cette enquête : les automobilistes eux-mêmes sont peu dépendants de la voiture et disposent en réalité de nombreuses alternatives. Ainsi, parmi les personnes interrogées venues en voiture, 87% utilisent également d’autres moyens de transport pour venir en centre ville (transports en communs, à pied, à vélo). De plus, 70% d’entre eux affirment qu’ils seraient quand même venus en centre ville s’ils n’avaient pas eu la possibilité de prendre la voiture le jour concerné. Autrement dit, la voiture ne conditionne absolument pas les venues en centre ville de la plupart des citoyens.
Ces résultats se retrouvent aussi localement, à Nancy. SCALEN, l’agence d’urbanisme locale, publiait ainsi une étude en octobre 2021, en se basant sur un échantillon de presque 1 500 personnes. Parmi les personnes interrogées s’étant rendues en zone piétonne, 39% d’entre elles s’y sont rendues à pied, 13% en vélo, 12% en transports en communs, et 35% en automobile. Cette étude apporte également une clé de compréhension fondamentale, puisqu’elle a également mené à la sollicitation de presque 200 (178) commerçants du centre-ville. Il leur a été demandé, entre autres, quel était selon eux le mode de déplacement utilisé par leurs clients pour se rendre en centre-ville. En moyenne, les commerçants estiment que 77% de leurs clients se sont déplacés en automobile. En réalité, ils sont plus de deux fois moins nombreux (seulement 35%). De fait, le nombre de personnes se déplaçant de manière non motorisée (à pied et à vélo) est estimé à 12% par les commerçants : en réalité, il est presque cinq fois supérieur (52%).
Les clients de ces commerces de centre-ville ont également été interrogés sur leur avis concernant l’extension de la zone piétonne. 78% d’entre eux se déclarent d’ailleurs favorables à l’extension de la piétonisation (dont 55% s’y montrent très favorables). La croyance que la piétonisation nuit au commerce n’est donc qu’une illusion, littéralement : une perception erronée qui diffère de la réalité objective. Le cas nancéien le confirme.
Pour autant, il est évident que certains commerces locaux souffrent ces derniers mois d’une baisse de leur chiffre d’affaires. Toutefois, l’explication d’un tel phénomène doit être multifactorielle et ne saurait s'expliquer uniquement par la piétonisation. En effet, la piétonisation ne peut être le prétexte de problématiques plus profondes.
Citons ici deux éléments majeurs qui ne sauraient être négligés : ces dernières années, la hausse du coût de la vie et la stagnation des salaires ont entraîné une baisse du pouvoir d’achat pour de nombreux français. De plus, les plateformes de vente en ligne ont explosé depuis la période covid. La combinaison de ces deux facteurs est donc claire : les français se rendent donc de moins en moins dans leurs commerces locaux, indépendamment de la piétonisation…
Enfin, notons qu’il serait artificiel de n’aborder la question de la piétonisation au seul prisme de l’activité commerciale. En effet, elle apporte bien plus. En encourageant la marche à pied, elle participe à l'effort de santé publique ; en favorisant les mobilités décarbonées, elle participe à réduire la pollution atmosphérique et sonore. Surtout, elle apporte une valeur hédonique forte à la cité ducale : l’expérience urbaine devient plus agréable.
La piétonisation continue : et maintenant ?
Désormais, quel sera le prochain secteur piétonisé ? Bien que les options peuvent sembler nombreuses sur le papier, elles se heurtent parfois à la réalité logistique de la cité ducale : la piétonisation de la place Carrière pose par exemple la question de l’avenir du parking Vaudémont. Mais fort d’une volonté politique, tout est possible ; encore plus lorsque la population locale y marque son soutien. Ainsi, dans le dernier baromètre municipal annuel (OpinionWay pour la Ville de Nancy, décembre 2024), l’extension de la piétonisation à la place Saint-Epvre récoltait un taux d’adhésion de 72%. Nul doute que la question de la piétonisation sera largement abordée lors des prochaines échéances électorales locales.
(illustration : Ville de Nancy)